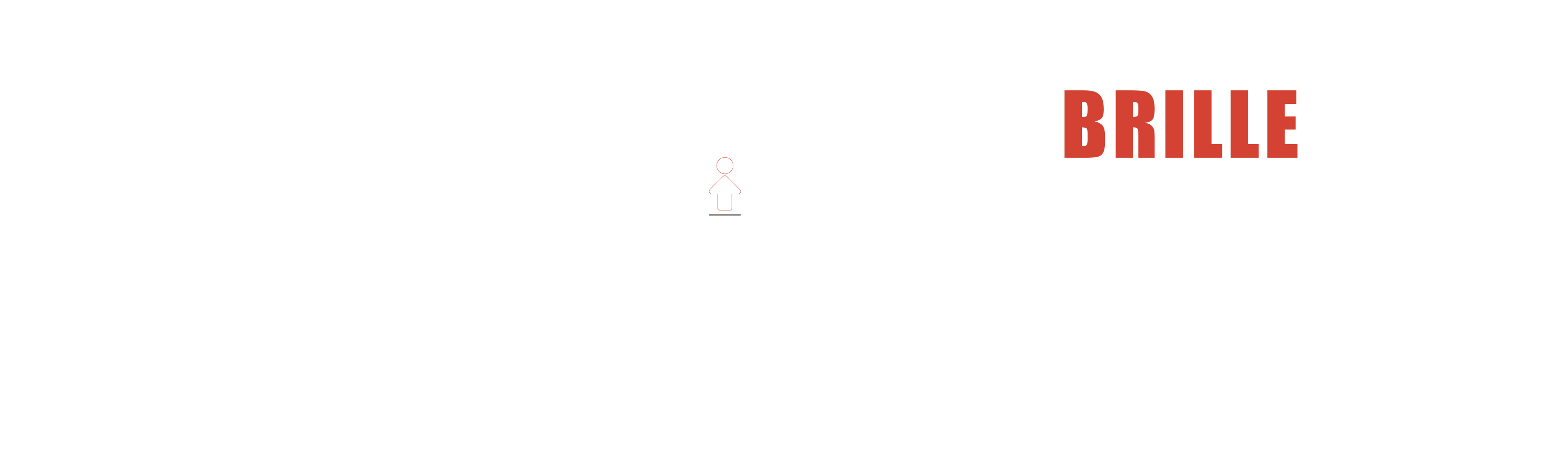Texte de Élodie Grenon.
Des années 1980 à aujourd’hui
Dans les années 80, la hausse du chômage pousse les centrales syndicales à adapter leurs tactiques. Pour la FTQ, cela se traduit par une volonté de collaborer avec les entreprises pour sauvegarder les emplois. Cette volonté mène à la création, en 1983, du Fonds de solidarité de la FTQ. En plus d’offrir un régime d’épargne-retraite à la population syndiquée et non syndiquée, le fonds réinvestit les sommes dans l’économie. À son lancement, 542 000 Québécois contribuent à un REER (Fournier, 1991). En 2022, ils sont plus de 750 000 uniquement au Fonds de la FTQ (Fonds de solidarité FTQ, 2022). Pour le créer, il aura fallu la collaboration du gouvernement du Québec qui a soumis la proposition au vote de l’Assemblée nationale. La collaboration ne s’arrêtera pas là, car l’État invite aussi les syndicats à participer aux Sommets socioéconomiques qui cherchent des solutions à la crise de l’époque (Collombat et Noiseux, 2016).
D’un autre côté, les conflits avec les employeurs se poursuivent. De 1979 à 1985, on estime que 21 % des grèves sont en fait des lockouts, arrêts de travail mis en place par les employeurs (Rouillard, 2004, p.207). Néanmoins, certains gains obtenus, notamment en éducation, profitent à l’ensemble de la population. Les enseignants arrivent à négocier, en 1985, l’instauration d’un mécanisme obligeant les commissions scolaires à intégrer les élèves en difficulté (Meunier et Piché, 2012, p.171). Les enseignants parviennent aussi à soutirer les premiers congés pour responsabilité parentale (ibid.).
Au total, les avantages sociaux obtenus par les syndiqués représentent un ajout au salaire d’au moins 40 % en 1984, selon Rouillard (2004, p.204). Dans les années 90, les rencontres avec le gouvernement permettront également de réduire progressivement la semaine de travail de 44 à 40 heures pour tous, de créer un fonds destiné à la réinsertion sur le marché du travail et d’obtenir plusieurs promesses concernant, notamment, la lutte contre la pauvreté (Rouillard, 2004, p.258).
En 1996, les syndicats se réjouissent de l’adoption de la Loi sur l’équité salariale, une revendication de longue date. Ainsi les organismes publics, tout comme les entreprises privées, sont tenus de corriger les écarts entre le salaire des hommes et des femmes. Concrètement, cette loi se traduira par un rattrapage salarial important pour ces dernières. Dans un contexte où le secteur des services et le travail atypique sont en croissance, le nombre de femmes sur le marché du travail devient pratiquement égal à celui des hommes (Rouillard, 2004, p.217).
Pour une plus grande inclusion
Au début des années 2000, les syndicats misent sur la collaboration. La syndicalisation des travailleurs non permanents ou à temps partiel progresse de façon fulgurante selon Noiseaux (2014, p.113). En marge du Sommet des Amériques, le Forum syndical réunit 1 000 syndicalistes d’une trentaine de pays qui s’entendent tous pour un développement axé sur l’amélioration des conditions de vie (Rouillard, 2004, p.268). Le Front commun, regroupant les trois grandes centrales syndicales du Québec, poursuit ses activités. L’année 2010 sera d’ailleurs marquée par le plus grand Front commun jamais vu avec près de 500 000 travailleurs, rapporte Meunier et Piché (2012, p.194). Des gains significatifs sont alors obtenus concernant les conditions de travail des syndiqués. Mais, certaines avancées vont aussi profiter à la population générale. En éducation, par exemple, les enseignants parviennent à obliger les écoles à évaluer les élèves en difficulté d’apprentissage pour mieux leur apporter l’aide à laquelle ils ont droit (Meunier et Piché, 2012, p.175).
De façon générale, une des plus grandes réussites du mouvement syndical consiste à s’immiscer dans les organismes publics pour représenter les intérêts de tous les travailleurs, et pas uniquement de celles et ceux qui sont syndiqués. Par exemple, c’est aux côtés de l’État, des employeurs et de différents partenaires que le mouvement syndical participe à l’élaboration des politiques d’Emploi-Québec, au sein de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). De même, la participation des syndicats à la Commission des normes sur l’équité, la santé et la sécurité du travail (CNESST) est essentielle pour la gestion des programmes qui affectent tous les salariés québécois. À cela s’ajoute toute la représentation effectuée dans le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre, l’Office des personnes handicapées, le Conseil supérieur de l’éducation, l’Office québécois de la langue française, etc. (Collombat et Noiseux, 2016, p.114).
L’influence de la syndicalisation sur la société
On peut vraiment constater que le mouvement syndical contribue de façon significative à l’amélioration des conditions de vie des non-syndiqués. Selon Dwayne et ses collaborateurs (2012, dans Rouillard et Rouillard, 2015, p. 18), il est même possible de conclure que les entreprises présentant des travailleurs non syndiqués vont s’ajuster aux conditions de travail des syndiqués afin de se montrer plus compétitives et d’améliorer leur rétention de travailleurs qualifiés. Depuis la création des syndicats, ceux-ci seraient la source d’un effet d’entraînement non-négligeable attribuables à leurs actions. La croissance économique et l’implication de l’État, ont aussi contribués à l’augmentation des salaires (Rouillard et Rouillard, 2015).
Au Québec, la présence syndicale est particulièrement élevée. Selon les chiffres de 2022, 38,8 % des emplois seraient syndiqués (Institut de la statistique du Québec, 2023). Ainsi, la province présente le plus haut taux de syndicalisation au Canada, sans commune mesure avec celui des États-Unis (environ 10 % en 2022 selon Statista). Or, le maintien de lois favorables aux syndicats n’est pas étranger à cette situation. Cela revient donc à dire que si le Québec veut maintenir un taux appréciable de syndicalisation, et donc assurer l’amélioration des conditions de travail pour tous, les citoyens doivent demeurer vigilants et éviter un recul de ces conditions gagnantes, mises en place par l’État en réaction aux efforts soutenus des syndicats.
Références
Collombat, T., & Noiseux, Y. (2017). Le syndicalisme est-il un groupe de pression? Groupes d’intérêt et mouvements sociaux, 105. https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4856801.
Fournier, L. (1991). Solidarité Inc., un nouveau syndicalisme créateur d’emplois. Québec Amérique. https://www.fondsftq.com/-/media/Site-Corporatif/Fichiers-PDF-Centre-de-documentation/2015/Solidarite_1991_livre.pdf
Meunier, A., & Piché, J. F. (2012). Une histoire du syndicalisme enseignant: de l’idée à l’action. PUQ.
Noiseux, Y. (2014). Les théories syndicales et le travail atypique : un bref retour sur la littérature. Transformations des marchés du travail et innovations syndicales au Québec. PUQ.
Rouillard, J. (2004). Le Syndicalisme québécois: deux siècles d’histoire. Éditions du Boréal.
Rouillard, J., & Rouillard, J.-F. (2015). Salaires et productivité du travail au canada depuis le début du 20ₑ siècle : les travailleurs bénéficient-ils de la croissance économique? Relations Industrielles, 70(2), 353–380. https://doi.org/10.7202/1031489ar
https://fr.statista.com/statistiques/1380222/taux-syndicalisation-etats-unis/