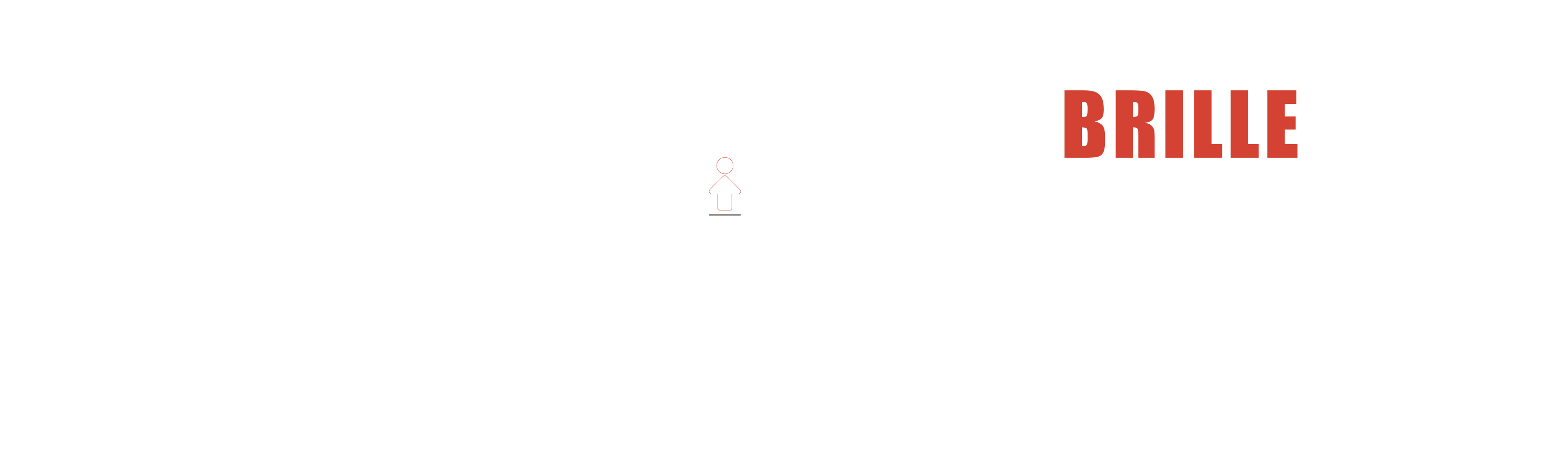Texte de Élodie Grenon.
Les retombées de la révolution tranquille
Comme partout ailleurs dans la société québécoise, la Révolution tranquille des années 1960 a un profond impact sur le mouvement syndical. Bien sûr, l’avancée du mouvement progressiste est aussi favorable au syndicalisme. Ce dernier a plus que jamais l’oreille attentive des autorités. Plusieurs réformes qui étaient demandées par les syndicats depuis longtemps se concrétisent. La majorité d’entre elles bénéficient aussi aux non-syndiqués, les grandes centrales syndicales de l’époque favorisant une plus grande intervention de l’État dans les affaires sociales et économiques. Conjointement, elles demandent, dès 1966, la création d’une assurance-maladie universelle (Rouillard, 2004, p.126).
La syndicalisation des employés de l’État
Le changement percole aussi au sein des syndicats eux-mêmes. La CTCC se déconfessionnalise et devient la Confédération des syndicats nationaux (CSN) en 1960. La montée du nationalisme francophone est aussi à l’origine du délaissement des syndicats américains. En 1963, le Syndicat canadien de la fonction publique, le plus gros syndicat affilié de la FTQ, est créé (SCFP). Il est né de la fusion de l’Union nationale des employés publics (UNEP) et de l’Union nationale des employés des services publics (UNESP).
Un gain majeur pour les syndicats dans cette période fut l’obtention du droit de négociation et de grève pour les employés de l’État (en 1964 pour le Québec et en 1967 pour le Canada). Le Québec devient un chef de file en matière de lois du travail touchant le syndicalisme. S’en suivra un rattrapage salarial important pour les fonctionnaires (Rouillard, 2004, p.182) et une augmentation des membres des centrales syndicales (Rouillard et Rouillard, 2014, p.18), qui se radicalisent. C’est d’ailleurs après l’imposition, par le gouvernement québécois, d’une échelle salariale aux travailleurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux en 1968 que les centrales commencent à songer à former une plus grande unité.
L’expérience du Front commun
Ce sera chose faite au début des années 70, quand la Centrale de l’enseignement du Québec – aujourd’hui la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) – s’associera avec la CSN et la FTQ pour créer le mouvement du Front commun. Ce dernier a pour but de négocier les conventions collectives à venir des 200 000 employés de l’État avec le gouvernement du Québec. Selon Rouillard (2004, p.183), il s’agit d’une première en Amérique du Nord. En 1971, le Front commun parvient notamment à obtenir un régime de retraite destiné aux employés des organismes publics et du gouvernement (Meunier et Piché, 2012, p.148). L’année suivante, après l’emprisonnement des trois chefs syndicaux pour avoir brièvement encouragé la désobéissance civile (Marcel Pépin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau), les travailleurs du secteur privé rejoignent eux aussi le mouvement. Au mois de mai, ils sont environ 300 000 à débrayer illégalement (Meunier et Piché, 2012, p.132).
Pour mobiliser les non-syndiqués, le Front commun peut compter sur une campagne de sensibilisation télévisuelle, qui explique l’appauvrissement des travailleurs du secteur public (Meunier et Piché, 2012, p.136). Le message portera ses fruits et les employés de l’État profiteront d’une hausse salariale importante en 1976. Les conditions de travail et avantages obtenus durant ces négociations auront aussi un effet d’entraînement sur les entreprises du secteur privé (Rouillard, 2004, p.180). En 1975-1976, on calcule que les divers avantages sociaux obtenus ajoutent 31 % au salaire des travailleurs canadiens (Ostry et Zaidi, 1979, p.202-203 dans Rouillard, 2004, p.204).
Des gains pour le mouvement et pour la société
Pour les syndicats, l’heure est aussi venue de s’attarder à la condition féminine. On réclame notamment : des congés de maternité payés, un réseau public de garderie, l’équité salariale, des politiques contre le harcèlement sexuel, l’accès à l’avortement et plusieurs autres mesures (Rouillard, 2004, p.193). Les enseignantes syndiquées obtiendront d’abord un congé de maternité sans solde de 17 semaines en 1976. C’est déjà une grande différence avec la coutume d’avant 1967, qui consistait à simplement mettre à pied les enseignantes qui étaient enceintes (Meunier et Piché, 2012, p.148)! En 1978, elles obtiendront un congé payé de 20 semaines, de même qu’un congé payé pour les pères d’une durée de cinq jours. Plus tard, les gains obtenus par les travailleuses syndiquées seront aussi obtenus par celles du secteur privé puis finalement, appliqués à l’ensemble de la population.
À cela s’ajoute une meilleure protection contre les accidents de travail, obtenue suite à la grève de l’amiante de 1975. Après que des mineurs de Thetford Mines se soient présentés à la CSN gravement atteints de maladies sévères, la centrale mène une enquête. Cette dernière résultera en la formation de la Commission Beaudry, qui blâme finalement les entreprises impliquées et le gouvernement québécois (Rouillars ,2004, p.194). S’ensuivra une réforme des lois sur la sécurité au travail et une bonification des indemnisations. Alors que les conflits de travail se multiplient – il y a 4,5 fois plus de grèves et de lockout de 1961 à 1980 que durant les deux décennies précédentes, selon Rouillard [2004, p.206]) – les avancées syndicales se poursuivent.
Avec la loi 45 votée en 1977, la perception de la cotisation syndicale est devenue obligatoire pour l’employeur. C’était une revendication syndicale depuis 1947, alors que le juge Rand donna son nom à une formule permettant la retenue à la source des cotisations, pour les employés, d’une usine de Ford en Ontario. La province de Québec modifie aussi le Code du travail pour y inclure, entre autres, des mesures contre les briseurs de grève. Selon Collombat et Noiseux (2016), le Québec devient ainsi « la province canadienne où les lois du travail sont les plus favorables aux syndicats » (p113-114). Résultat : la syndicalisation touchera près de 40 % des travailleurs en 1978 (Rouillard et Rouillard, 2015, p.18).
Références
Collombat, T., & Noiseux, Y. (2017). Le syndicalisme est-il un groupe de pression? Groupes d’intérêt et mouvements sociaux, 105. https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4856801.
Meunier, A., & Piché, J. F. (2012). Une histoire du syndicalisme enseignant: de l’idée à l’action. PUQ.
Rouillard, J. (2004). Le Syndicalisme québécois: deux siècles d’histoire. Éditions du Boréal.
Rouillard, J., & Rouillard, J.-F. (2015). Salaires et productivité du travail au canada depuis le début du 20ₑ siècle : les travailleurs bénéficient-ils de la croissance économique? Relations Industrielles, 70(2), 353–380. https://doi.org/10.7202/1031489ar
Syndicat canadien de la fonction publique. Le SCFP au Canada. https://scfp.qc.ca/le-scfp-au-canada/
Syndicat canadien de la fonction publique. 1963-1972 : transformer le mouvement syndical. https://scfp.ca/1963-1972-transformer-le-mouvement-syndical