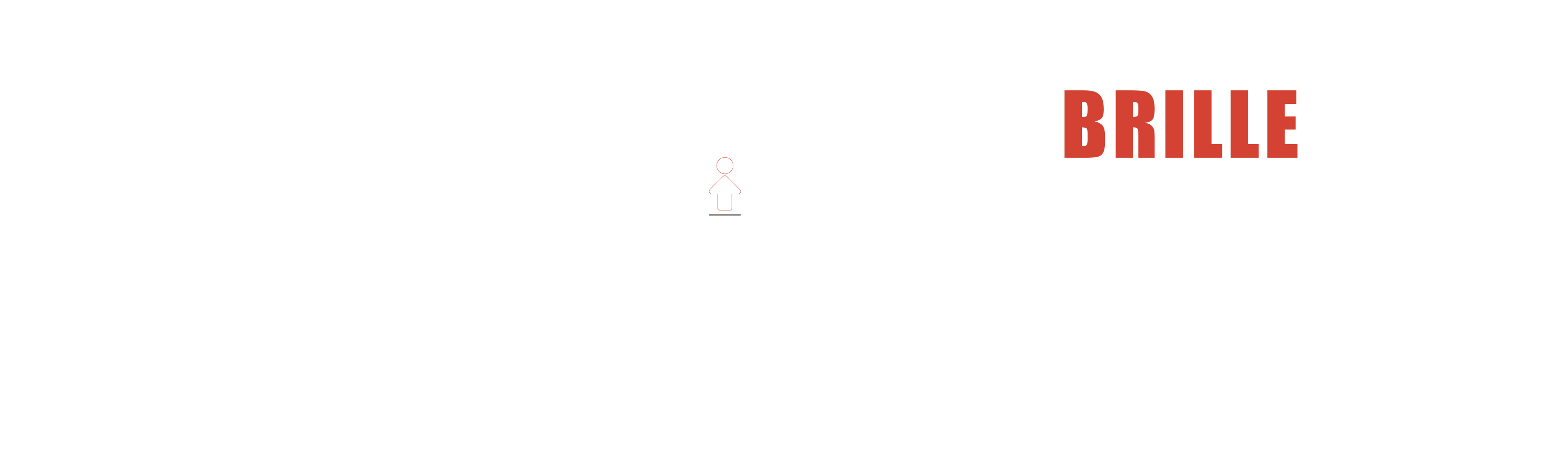Texte de Élodie Grenon.
Les progrès du syndicalisme
Au début du XXe siècle, on remarque qu’une économie et un contexte social prospères induisent un pouvoir syndical accru. À cette période, les gains sociaux attribuables aux mouvements syndicaux sont appréciables, même pour la population non syndiquée. Parallèlement à l’augmentation des conflits de travail (en nombre et en intensité), on observe un raccourcissement de la journée de travail de 60 heures à 54-55 heures. Cela permet à certains travailleurs d’obtenir une journée et demie de congé par semaine (Rouillard, 2004). De façon générale, on note une amélioration des salaires et des conditions de travail, d’abord à Montréal et à Québec, ensuite dans les autres villes de la province (Rouillard, 2004). Le plein emploi et l’impératif de l’effort de guerre lors des conflits mondiaux ne sont pas sans effets sur le rapport de force des syndicats.
C’est aussi pendant cette période que les grands conseils syndicaux que l’on connaît aujourd’hui sont formés. La Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), qui deviendra plus tard la CSN (en 1960), sera d’ailleurs formée en 1921 par suite de la montée du syndicalisme catholique. On retrouve aussi les syndicats internationaux qui militent déjà, au Canada, pour la création de programmes fédéraux d’assurance-chômage, de pension de vieillesse et d’assurance maladie.
En 1934, la CTCC est l’instigatrice de la loi d’extension juridique qui permet au gouvernement d’étendre la portée d’une convention collective à l’ensemble des entreprises d’un même secteur industriel, situées sur un territoire précis. Cette loi a un impact positif sur le taux de syndicalisation au Québec qui augmente de façon importante : près du tiers des salariés québécois seront syndiqués en 1945 (Rouillard, 2004).
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement syndical connaît plusieurs changements. D’abord, les travailleurs sont regroupés selon l’usine qui les emploie et non plus selon leur métier. Les grèves, bien qu’elles soient courtes, atteignent un nombre record : 756 grèves et lockout ont lieu au Canada en 1942-1943, selon Rouillard et Rouillard (2015). Celles-ci permettent au mouvement syndical de faire des gains importants.
En 1944, le gouvernement canadien, avec la Loi sur les relations ouvrières, oblige les employeurs à négocier avec leurs salariés. Le gouvernement du Québec va encore plus loin en présentant un cadre spécifique incluant le processus d’accréditation des syndicats, l’obligation pour l’employeur de négocier de bonne foi et le processus d’arbitrage en cas d’impasse, entre autres nouveautés. Cette loi, qui constitue encore la base des relations de travail aujourd’hui, est une grande victoire pour le mouvement syndical (Rouillard, 2004).
Mais cette période est aussi marquée par une défaite cuisante : la grève de l’amiante en 1947. Alors que près de 5 000 mineurs de la région de Thetford s’opposent à leurs employeurs durant quatre mois, le conflit tourne à la violence. Les images mobilisent la population, syndiquée et non-syndiquée, population qui fait preuve de solidarité et de générosité, faisant des dons d’argent et de nourriture pour soutenir les grévistes et leurs familles. Bien que les mineurs n’aient pas remporté leur cause, la valeur symbolique du conflit provoquera un élan de sympathie chez la population et, à plus long terme, une plus grande écoute des gouvernements (Rouillard, 2004).
En 1957, l’alliance de deux fédérations syndicales (la Fédération provinciale du travail créée en 1937 et la Fédérations des unions industrielles du Québec fondée en 1952) mène à la création officielle de la Fédération des travailleurs du Québec : la FTQ. Elle s’engage principalement à représenter les intérêts de ses membres auprès du gouvernement du Québec et du Congrès du travail du Canada (CTC), avec lequel elle est affiliée. L’année suivante, la FTQ collabore avec la CTCC, l’ancêtre de la CSN, afin de déposer un mémoire qui, selon Rouillard (2004), inspirera grandement la réforme de l’éducation des années 60. On y retrouve déjà des recommandations sur l’instauration de bourses d’études, l’obligation de fréquenter l’école jusqu’à 16 ans, la suppression des frais de scolaires incluant ceux des manuels, etc.
Durant cette période, les gains pour les travailleurs syndiqués, et par ricochet les non-syndiqués, seront nombreux. Grâce, en partie, à la prospérité économique provoquée par l’après-guerre, le salaire réel augmente en flèche. La rémunération à taux horaire et demi pour les heures supplémentaires est popularisée; la semaine de travail s’aligne sur les 40 heures qu’on lui connaît maintenant dès la fin des années 50; les emplois, grâce notamment à la reconnaissance de l’ancienneté, deviennent plus stables; et à cela s’ajoutent de nombreux avantages sociaux comme les congés de maladie payés, les vacances bonifiées, l’augmentation du nombre de jours fériés, les régimes d’assurances collectives et la contribution de l’employeur à la retraite (Rouillard, 2004).
Selon certains calculs, on considère que tous les travailleurs canadiens profitent d’une augmentation de 22 % de leurs revenus à cause de ces ajouts (Ostry et Zaidi, 1979 dans Rouillard, 2004). Au croisement des autres évolutions de la société québécoise, la classe ouvrière passe donc de ce que certains sociologues nomment l’univers des besoins à celui des aspirations. Elle peut notamment envisager la possibilité d’accéder à la propriété et celle d’une éducation supérieure pour la génération suivante.
Références
Rouillard, J. (2004). Le Syndicalisme québécois: deux siècles d’histoire. Éditions du Boréal.
Rouillard, J., et Rouillard, J.-F. (2015). Salaires et productivité du travail au canada depuis le début du 20ₑ siècle : les travailleurs bénéficient-ils de la croissance économique? Relations Industrielles, 70(2), 353–380. https://doi.org/10.7202/1031489ar